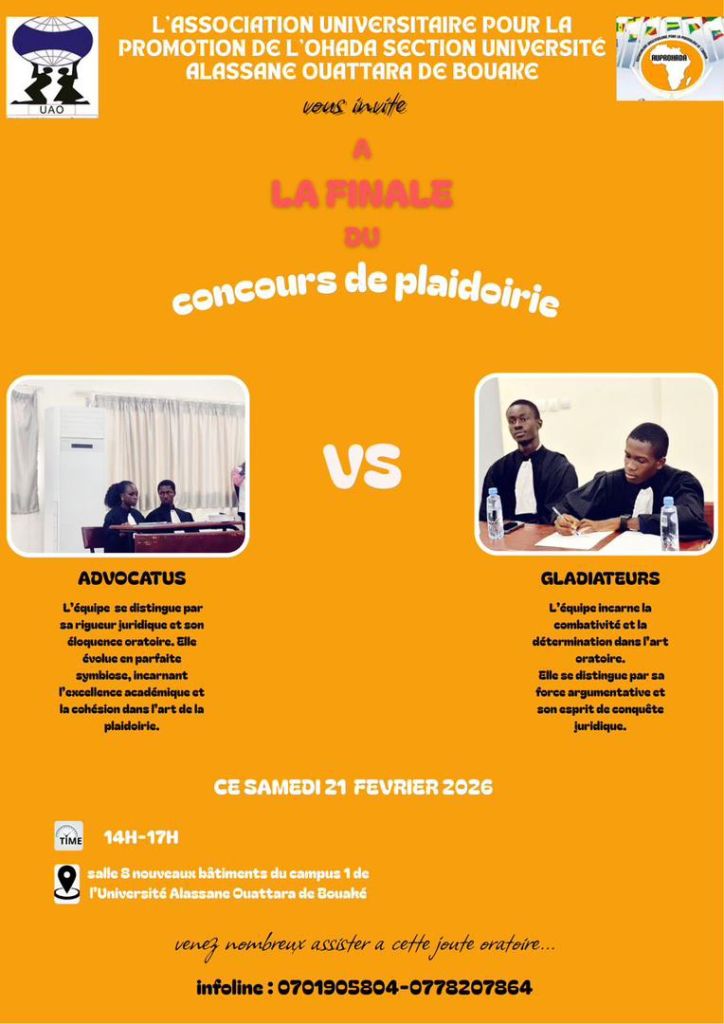Compte rendu de la Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, les 20 et et 21 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)
- 24/02/2026
- Cercle OHADA du Burkina
- Laisser un commentaire
- 🇧🇫
Cette activité à vocation scientifique a débuté le vendredi 20 février en présence de nombreux étudiants des Universités et Instituts supérieurs publics et privés où est dispensé le droit des affaires OHADA. Apres l'ouverture symbolique, les participants ont eu droit à trois (3) panels de haut niveau animés par des spécialistes, des praticiens de la matière.